Devenus un sujet d’affolement, les cas d’infestation de punaises de lit sont en augmentation constante en France au fil des années. On l’a oublié, mais, en Occident, ces insectes avaient pourtant disparu au milieu du XXe siècle. Un progrès permis par un produit aux propriétés salvatrices, le DDT, qui, malgré ses effets sanitaires spectaculaires en matière d’éradication et de contrôle des vecteurs de maladie, a été interdit en France dans les années 1970. Cette erreur, on la doit à l’inconséquence écologiste. Si nos politiques redoublent aujourd’hui de créativité pour expliquer la façon dont l’État va lutter contre cette nouvelle épidémie, ils ne prévoient toujours pas de la réparer. L’étatisme ou le serpent qui se mord la queue ?
L’automatisme étatique français
L’impression d’une invasion. Chambres à coucher, transports en commun, fauteuils de cinéma… Depuis quelques semaines, des témoignages alertant sur la prolifération des punaises de lit dans tous les lieux de notre quotidien affluent sur les réseaux sociaux, semant une panique largement alimentée par les gros titres de la presse et les discours alarmistes d’une partie de la classe politique.
Sans surprise, devant l’emballement médiatique, chaque camp politique a appelé l’État à s’emparer du sujet. La majorité présidentielle a ainsi annoncé une proposition de loi en décembre, appelant tous les groupes de « l’arc républicain » à se joindre à cette initiative législative. De son côté, la cheffe de file de la France insoumise, Mathilde Panot, après avoir étrillé l’inaction du gouvernement et brandi, au sein de l’Hémicycle, une fiole remplie de punaises de lits mortes, a réclamé un « service public de la désinsectisation », évidemment « gratuit ».
Une séquence mettant en lumière, une fois de plus, l’un des éternels travers qui caractérisent la culture politique française : le réflexe étatique, partagé par la majorité de la population. Selon un sondage YouGov pour le HuffPost, 55% des Français estiment en effet que le gouvernement devrait lancer un plan national contre les punaises de lit. De quoi rappeler cette remarque d’Alexis de Tocqueville : « La plupart estiment que le gouvernement agit mal ; mais tous pensent que le gouvernement doit sans cesse agir et mettre à tout la main ».
Un étatisme pyromane
Pourtant, c’est ce même État, auquel les citoyens s’empressent de demander de l’aide… qui est à l’origine de la réapparition de ces insectes depuis la fin du XXe siècle. S’il est à ce stade impossible d’affirmer que leur nombre « explose », on peut dire avec certitude qu’il est en forte hausse, et cela ne date pas d’hier.
Depuis le début des années 1990, la France et, plus largement, l’Europe, font face à une recrudescence des punaises de lit, pointait en 2015 un rapport du Centre national d’expertise sur les vecteurs (CNEV) – un organisme sous la tutelle des ministères de la Santé et de l’Agriculture, en place de 2011 à 2016. « Depuis les années 1990, la punaise de lit a réémergé dans notre quotidien », confirme un avis rendu en juillet dernier par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Car ces bestioles avaient bel et bien disparu durant les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale. Comment ? La réponse tient en trois lettres : DDT. Pulvérisé en grande quantité à l’intérieur des maisons, le Diphényle-Trichloro-Ethane, premier insecticide de synthèse véritablement efficace, avait permis d’éradiquer les punaises du monde occidental à partir des années 1950, alors que les pays communistes étaient toujours en proie à une épidémie généralisée.
La diabolisation du DDT et ses conséquences
Malgré son utilité et son innocuité pour l’homme, ce produit a été banni dans les années 70 sous la pression du lobby écologiste. L’histoire de cette interdiction démarre à la parution en 1962 de « Silent Spring » (« Printemps silencieux »), ouvrage de Rachel Carson, une romancière aujourd’hui considérée comme pionnière de l’écologie politique. Extinction de la biodiversité, développement des cancers, hausse de l’infertilité… Cet essai brosse un portrait catastrophiste, presque biblique, des conséquences de l’utilisation du DDT. Faisant l’effet d’une bombe, il aboutit 10 ans plus tard, en 1972, à la proscription de la substance par l’Agence pour la protection de l’environnement américaine. Une décision également adoptée par la France, le reste de l’Europe et la vaste majorité des pays du monde, dont les effets conduiront à un désastre sanitaire.
En dehors du retour des punaises de lit, le bannissement de cet insecticide s’est en effet accompagné d’un autre fléau : une hausse majeure du paludisme, maladie infectieuse parmi les plus meurtrières du XXe siècle. À partir des années 1960, grâce au DDT, la malaria avait été complètement éliminée dans 11 pays, dont les États-Unis. En Grèce, l’épidémie avait pris fin en l’espace d’une seule année. Au Népal, avant que l’épandage ne commence dans les années 1960, plus de deux millions de Népalais, principalement des enfants, souffraient de cette affection. En 1969, ce nombre a été réduit à 2 500.
En Inde, entre 1952 et 1961, de 75 millions de cas, ce chiffre chute aux environs de 50.000, avant de remonter à 6 millions à la fin des années 70 en raison de l’impossibilité de recourir au DDT. Même scénario au Sri Lanka, qui comptait auparavant 2,8 millions de malades : le paludisme avait pratiquement disparu pour mieux revenir en force dès que le produit a cessé d’être utilisé (un demi-million de victimes en 1969). L’interdiction de cet insecticide a donc bien conduit à un vrai massacre.
Cette réalité est cependant contestée par certaines associations écologistes et quelques médias, à l’instar du journaliste du Monde Stéphane Foucart, qui n’hésite pas à dénoncer une « légende forgée et diffusée par les milieux néoconservateurs américains ». Selon lui, « le DDT a progressivement perdu du terrain dans la lutte anti-vectorielle depuis les années 1970 pour la principale raison de l’apparition, dans certaines régions, de résistances des anophèles à cet insecticide », reprenant ainsi à son compte les déclarations de Greenpeace.
Pourtant, comme l’écrit l’Association française pour l’information scientifique (AFIS), si quelques résistances sont identifiées, le produit n’est pas pour autant inefficace. Une thèse étayée par l’OMS en 2006, qui à partir de cette date, va de nouveau recommander l’usage du DDT au motif que la pulvérisation de DDT à l’intérieur des habitations n’est dangereuse ni pour l’homme ni pour la faune et la flore : « Malgré des décennies d’application intensive et généralisée, des niveaux significatifs de résistance ont été limités à certaines espèces de vecteurs et à certaines régions géographiques. Mais depuis que l’utilisation du DDT est réservée à des actions sanitaires, les populations de vecteurs ne sont plus exposées au DDT pour des raisons autres, ce qui réduit encore les candidats à une sélection et au développement de résistances ».
Le DDT, un produit sûr et efficace dans le cadre d’un usage sanitaire
Aujourd’hui, les types d’insecticides les plus utilisés sont les pyréthrinoïdes mais, comme on le constate avec les punaises de lit, les insectes commencent à développer des résistances. Il serait donc nécessaire de disposer d’un autre produit à utiliser en alternance. De nos jours, rares sont ceux qui contestent l’interdiction du DDT en tant que pesticides d’épandage dans l’environnement, mais son utilisation intradomiciliaire demeure un outil à usage sanitaire sûr et efficace.
Pourtant, aucune figure politique n’a proposé de revenir sur l’interdiction du produit même qui a permis d’éradiquer les punaises de lit au milieu du XXe siècle. Aussi, cette infestation, in fine, risque de déboucher sur une énième extension du domaine d’intervention de l’État, pour un résultat coûteux et inefficace. Elle est malgré tout réclamée par une majorité de Français.




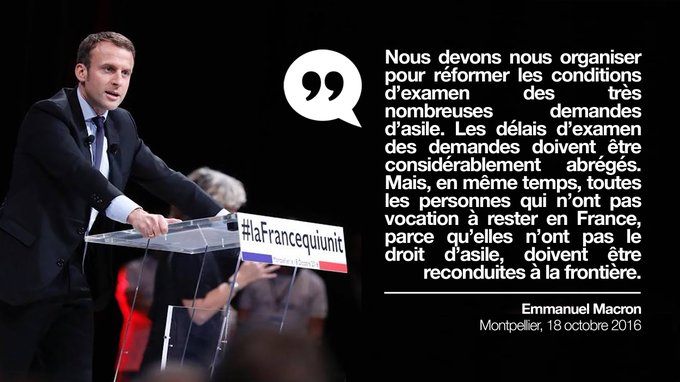
 On l'a dit.
On l'a dit.  On le fait.
On le fait.